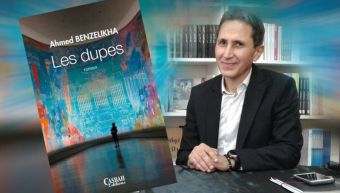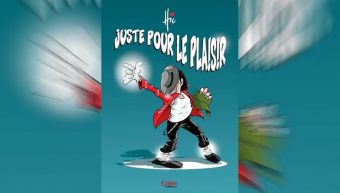Doctorante en études cinématographiques de l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Mathilde Rouxel revient dans cet entretien sur “le cinéma de lutte réalisé par des femmes”, à l’exemple d’Assia Djebar avec “La Nouba des femmes du mont Chenoua”.
Liberté : Votre travail de doctorat porte sur “le cinéma de lutte réalisé par des femmes en Égypte, en Tunisie et au Liban depuis 1967”. Comment ces cinéastes ont-elles pu s’imposer dans un domaine qui, à l’époque, était exclusivement masculin ?
Mathilde Rouxel : Le milieu n’était pas exclusivement masculin : on trouve déjà très tôt dans l’histoire des industries de ces trois pays des femmes productrices, scriptes, monteuses. L’industrie du cinéma égyptien, l’imposante Hollywood sur Nil, a mis en avant de nombreuses femmes, qui, dans quelques rares cas, se sont d’ailleurs retrouvées derrière la caméra : c’est le cas par exemple de Bahiga Hafez ou de Assia Dagher qui ont tenu le rôle de réalisatrice sur quelques mélodrames dans les années 1930. Par ailleurs, il est important de noter plusieurs réalités historiques.
Dans un premier temps, il faut souligner qu’en Tunisie comme au Liban une industrie nationale n’a pu naître qu’après l’indépendances des deux pays sous domination française. Dans un deuxième temps, nous devons constater que l’apparition tardive des femmes dans les cinématographies nationales n’est pas l’apanage du monde arabe : en France, il faut attendre Agnès Varda dans les années 1950 pour voir une femme derrière la caméra, et elle est restée seule longtemps, les autres réalisatrices faisant leur apparition à la fin des années 1960 – comme dans le monde arabe, finalement.
Les écoles de cinéma de cette époque (notamment l’IDHEC à Paris, l’INSAS en Belgique, qui était très prisées des étudiants du Maghreb ou du Machrek) n’ouvraient d’ailleurs pas les portes de leurs formations à l’image ou à la réalisation aux femmes : elles étaient contraintes d’être seulement scriptes ou monteuses.
Cette réalité a longtemps conditionné leurs professions dans l’industrie, et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les premières réalisatrices du monde arabe (les rares cadors de l’industrie égyptienne exceptés) ne sortaient pour la plupart pas d’écoles de cinéma : la Tunisienne Sophie Ferchiou (qui réalise Chéchia en 1966) est ethnologue, la Libanaise Jocelyne Saab (qui réalise son premier film en indépendante, Le Liban dans la tourmente, en 1975) est journaliste, sa compatriote Heiny Srour (qui réalise en 1974 L’Heure de la libération a sonné, premier film de femme arabe sélectionné au Festival de Cannes) étudiait l’anthropologie, etc.
Seul Le Caire, qui avait mis en place dans les années 1950 une école de cinéma a vu des femmes sortir de ses rangs formées pour l’image : c’est le cas de Atteyat Al-Abnoudi et de Nabiha Lotfy, qui réalisent leur premier film respectivement en 1971 et 1974.
Et quelles sont les raisons qui les ont poussées à s’engager à travers le cinéma ?
Les conditions politiques et sociales de l’époque, ainsi que l’héritage filmique des cinéastes femmes de ces années-là laissent toutefois penser que la défaite des armées arabes contre Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967 aient été motrices dans la motivation des femmes à faire elles-mêmes des images. En effet, cette année a été charnière pour les intellectuels arabes, et pour répondre au choc de cette humiliation, les artistes et cinéastes, des hommes, ont commencé à partir de 1968 à se réunir pour réfléchir à leur engagement artistique.
Plusieurs manifestes pour un cinéma “nouveau” ou “alternatif” émergent de ces discussions, mais les femmes ne sont généralement pas conviées aux débats. Il est clair toutefois qu’elles partagent l’esprit de résistance de l’époque, et, animées de la même envie de témoigner, de dénoncer et de lutter, elles réalisent leurs premiers films sur des terrains en guerre (la lutte des Palestiniens à la frontière syrienne, la guerre du Liban, l’Irak, le Dhofar, puis plus tard le Sahara occidental) ou sur des territoires marginalisés (dans les quartiers populaires ou les campagnes de l’Égypte ou de la Tunisie, en Iran après la révolution islamique, au sud du Liban bombardé par Israël, etc.).
Ces films montrent des images dissidentes par rapport aux images dominantes (le cinéma populaire, les journaux télévisés), différentes des autres images de résistance, produites par les hommes au nom du cinéma nouveau ou dans le cadre d’actions militantes. On y voit beaucoup d’enfants, on y entend beaucoup de femmes : dans les luttes, l’arrière est aussi important que le front.
Pourquoi seulement ces trois pays ont été précurseurs dans ce domaine ? En Algérie, Assia Djebar est la pionnière avec La Nouba des femmes du mont Chenoua, sorti en 1978. À votre avis, ce retard est dû à quoi ?
C’est le hasard de l’histoire qui a fait de ces trois pays les trois premiers pays à avoir vu des femmes s’emparer de la caméra. En effet, si l’Égypte a su développer très tôt une industrie pérenne et productive, basée sur le modèle star system (que l’on retrouve tant à Hollywood qu’à Bollywood), les autres pays de la région ont mis du temps à développer leurs propres structures nationales.
Pour étudier le cinéma, les cinéastes partaient en Europe de l’Ouest (Paris, Londres, Bruxelles) ou de l’Est (à Lodz, en Pologne ou à Moscou, en Russie). Il est donc clair que les pays francophones comme la Tunisie ou le Liban entretenaient à cette époque des liens privilégiés avec la France et que cela a facilité leur formation.
Sauf dans le cas de l’Égypte, qui offrait avec son école de cinéma une place aux femmes inexistante ailleurs dans la région, toutes les cinéastes de cette première vague de cinéma indépendant ont fait leurs études à l’étranger : les Libanaises Jocelyne Saab, Heiny Srour, Randa Chahal Sabbagh ont fait leurs études à Paris, comme les Tunisiennes Sophie Ferchiou ou Selma Baccar. Néjia Ben Mabrouk a, pour sa part, étudié à l’INSAS à Bruxelles.
Diplômées et bien implantées dans des milieux européens capables parfois de soutenir la production et la diffusion de leurs films, elles ont eu l’opportunité de faire de l’image une arme pour s’engager. La situation politique était aussi à considérer. Au pouvoir en Tunisie, Bourguiba promouvait pour sa part une politique favorable aux femmes.
Au Liban, les tensions politiques sensibles après 1967 poussaient la jeunesse à vouloir témoigner, notamment sur la situation des Palestiniens dans le pays. Le cas d’Assia Djebar, longtemps orphelin en Algérie, suit la même progression que celles des cinéastes que nous évoquons : des études parisiennes lui ont ouvert des portes pour publier ses premiers romans à Paris (La Soif, chez Julliard en 1957) avant de développer son envie de faire des films.
C’est par cet aller-retour en Algérie par un passage en France qu’elle parvient à s’imposer comme grande plume, puis comme cinéaste : à cette époque, les infrastructures nécessaires (de la production à la distribution) pour le développement d’une véritable industrie culturelle nationale étaient encore en construction : dans le domaine du cinéma, pendant longtemps, seuls quelques films étaient produits chaque année.
Jocelyne Saab est une référence dans le cinéma engagé. Quel a été l’impact de son œuvre sur le “7e art féminin” d’aujourd’hui ?
Je ne pense pas qu’on puisse parler de “7e art féminin”, car la désignation en soi ne réfère à aucune réalité (il n’y a pas d’“essence féminine” de la création), et très rares sont les réalisatrices, quel que soit leur pays d’origine, qui acceptent et revendiquent pour leurs films l’étiquette de “film de femme”. Jocelyne Saab, comme d’autres, ne réfléchit jamais son cinéma en fonction de son genre – “sous les lignes de feu, dit-elle en substance dans un entretien télévisé avec Jean-François Chauvel à la fin des années 1970, on ne se demande pas si on est un homme ou une femme”.
La question n’est pas pertinente dans le contexte des productions documentaires sur la libération des peuples dont Jocelyne Saab suit les luttes dans ses films : elle filme la résistance des Palestiniens (Les Femmes palestiniennes, 1974 ; Le Front du refus, 1975), les guérilleros du Front Polisario dans Le Sahara n’est pas à vendre (1978), les foules encore enthousiastes, deux ans après la chute du Shah d’Iran (Iran, l’utopie en marche, 1981). La question d’un cinéma féminin s’éloigne de la recherche de ces réalisatrices qui descendent sur le terrain pour témoigner, dénoncer et créer une archive pour l’écriture de l’histoire.
Jocelyne Saab se démarque d’autres cinéastes comme celles que nous avons citées ou d’autres, plus jeunes, comme les Tunisiennes Kalthoum Bornaz et Moufida Tlatli ou les Égyptiennes Tahani Rached et Asma El-Bakry, en raison non seulement du caractère prolixe de sa carrière (47 films, comptant des courts et longs métrages documentaires, des longs métrages de fiction et des vidéos d’art), mais aussi au regard de leur diversité. Ayant travaillé durant près de cinquante ans, elle a suivi, formé et inspiré de nombreux cinéastes au Liban et dans le monde arabe – dans une certaine mesure toutefois : comme la plupart de ces films, particulièrement les premiers réalisés au tournant des années 1970 et dans les années 1980, ils sont très difficiles d’accès pour les jeunes générations.
Les thématiques portées par les cinéastes des pays arabes sont-elles similaires à celles abordées par les Occidentales ?
Les combats n’étant jamais les mêmes d’une aire géographique à une autre, les logiques répondant à des histoires nationales spécifiques, les thématiques rencontrées dans les films ne sont pas les mêmes en Égypte, en Tunisie ou au Liban ; elles ne sont donc évidemment pas les mêmes que celles traitées par des réalisatrices issues de pays européens ou d’ailleurs.
Ces différences ne signifient pas toutefois que les influences d’un bord à l’autre de la Méditerranée sont inexistantes : le développement par exemple du “Fonds Sud” par Jack Lang, versé à partir de 1986 par le Centre national du cinéma français à des projets de films proposés par des cinéastes dits “du Sud”, a formaté certains sujet et certains stéréotypes de personnages, encore omniprésents dans le cinéma de fiction contemporain de la région.
Toutefois, ce cloisonnement thématique et cette autocensure naturelle poussée par le désir d’obtenir des fonds pour la réalisation du film concernent tant hommes que femmes : il n’y a pas de spécificité féminine dans la création, encore moins dans la production, à partir du moment où elle s’industrialise.
De nos jours, réalisatrices, comédiennes ou productrices du Maghreb et du Moyen-Orient ont-elles plus de facilités à exercer leur métier et à faire entendre leur voix à travers l’image ?
De nos jours, tout le monde a plus de facilités à réaliser des films : le développement du numérique à la fin des années 1990 et sa large démocratisation au début des années 2000 a transformé le rapport à l’image. Le développement d’internet et de plateformes telles que YouTube ou Vimeo ont par ailleurs transformé le rapport à la diffusion.
Ces dernières années, la production de documentaires est de plus en plus massive (moins coûteux et moins restreint par les autorisations de tournage, etc.) et les festivals de documentaires, comme les plateformes de streaming qui leur sont dédiées, se multiplient. Par ailleurs, les années 1990 ont vu se développer des écoles de cinéma.
Libérées de ces contingences économiques et mieux formées, davantage de femmes passent derrière la caméra. Par ailleurs, il est effectivement notable que la conjoncture actuelle, qui pousse à davantage d’équité dans les structures d’influence, permettent à plus de films de fiction produits par de grandes boîtes de distribution de voir le jour et de connaître une distribution internationale.
Malgré l’émergence de quelques évènements dédiés aux films de femmes, quelle est réellement leur place ?
La place des femmes est de plus en plus dans les festivals, aux côtés de leurs homologues masculins. Si l’on parle du cinéma arabe en particulier, il est évident que cette caractéristique est incontournable : au Liban, plus de 50% des cinéastes en activité sont des femmes.
Les réalités sociales perpétuent toujours des inégalités, et les événements dédiés aux cinémas des femmes (de l’écriture, en ateliers, à la diffusion en festivals) sont toujours importants et permettent l’émergence de nouvelles plumes et de nouveaux regards qui n’auraient peut-être pas rencontré leurs publics sans ces tremplins essentiels.
Toutefois, la réalité du terrain, de moins en moins dominée par des hommes, permet aux femmes de trouver leur place – dans la création, mais aussi à la tête de structures ayant de l’influence et du pouvoir (Marianne Khoury à la tête de Misr International Film au Caire, Hania Mroué à la tête de Metropolis à Beyrouth, ou encore Chiraz Latiri, ministre des Affaires culturelles en Tunisie jusqu’en septembre 2020, après avoir dirigé le Centre national du cinéma et de l’image – CNCI – durant deux ans).
Entretien réalisé par : HANA MENASRIA