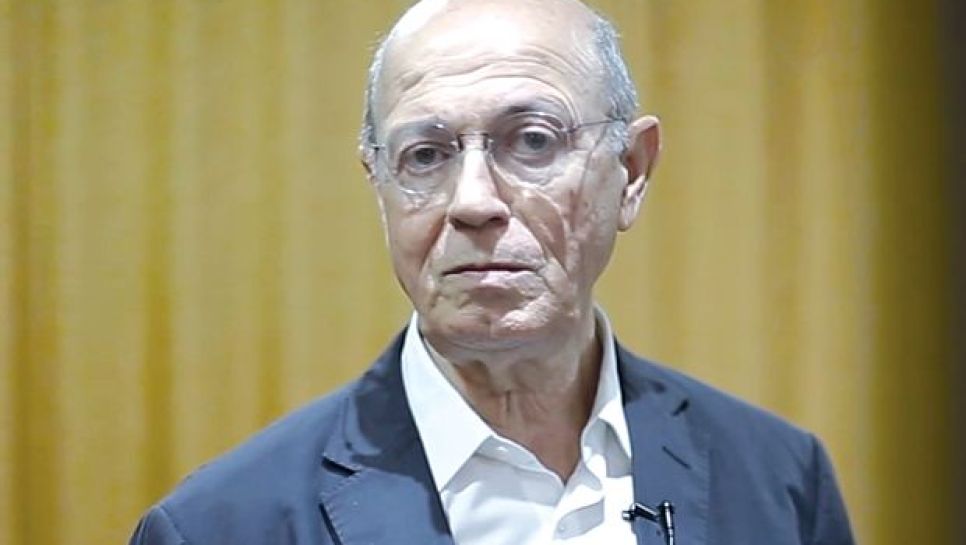
Aucune société n’est violente, mais toutes peuvent le devenir. De ce propos découlent le questionnement ou, plus approprié, les questionnements sur l’origine de tous ces maux qui rongent la société algérienne, résumés dans ce que nous appelons communément le mal-être collectif et général. Une violence, nous dit le professeur en psychiatrie, s’exprime à travers la harga, le suicide, la violence contre les femmes, les traumatismes enfouis de la décennie noire et sur laquelle l’on a “jeté le couvercle en oubliant d’éteindre le feu”, le repli sur soi ou encore le désir cultivé collectivement d’un ailleurs pas toujours meilleur : la harga. Dans le Hirak, le psychiatre voit “un désir de vivre en paix après une guerre civile meurtrière”. Dans cette interview, le professeur en psychiatrie, Farid Kacha, fait la radioscopie de la santé mentale de l’Algérien. Il apporte ainsi des éclairages pouvant aider à la compréhension des angoisses du pays et des craintes d’une société cernée par une violence multiforme.
Entretien
Liberté : Comment est la santé mentale des Algériens ?
Farid Kacha : Je voudrais vous préciser que je ne m’occupe pas précisément de la santé mentale des Algériens, mais de psychiatrie.
La psychiatrie est la spécialité médicale qui a pour objet la reconnaissance et la prise en charge des troubles mentaux. La santé mentale est une notion plus large qui inclut les effets cliniques de la souffrance d’origine sociale. Cette souffrance implique qu’il y a des dysfonctionnements dans les dispositifs qui règlent les relations des hommes entre eux. Ces dysfonctionnements peuvent toucher les familles, l’éducation et le respect de l’autre, l’organisation sociale, le système politique et les rapports gouvernants-gouvernés.
Ce qui veut dire que la santé mentale est l’affaire de tous, chacun de nous est un acteur de l’équilibre psychologique et du bien-être des citoyens dont il a la charge ou la responsabilité, du père de famille au président d’APC, en passant par le directeur de l’hôpital et les services de police.
Les difficultés économiques, la menace sur la santé de chacun installée par la pandémie, la multiplication des accidents de la route et des “harraga, etc. supposent l’existence d’une souffrance sociale, et son importance montre que notre santé mentale n’est pas au beau fixe.
L’Algérien est en permanence angoissé. Est-ce parce qu’il évolue dans une société peu rassurante et dans un cadre de vie étouffant ?
Les troubles anxieux sont très fréquents dans les pays comme le nôtre. Il faut se garder de ne pas confondre les troubles secondaires au stress, lorsqu’il s’agit d’un conducteur de bus à Alger par exemple, de l’inquiétude et de la tension psychologique induite par les nombreuses tracasseries de la vie urbaine, bureaucratique, les difficultés de déplacement, le changement permanent des règlements. L’angoisse est un sentiment et une sensation que nous ne sommes pas en sécurité et qu’il va nous arriver quelque chose de négatif.
Les nouvelles qui circulent à propos des difficultés sanitaires, du mauvais état de nos hôpitaux et de l’impossible fiabilité des informations officielles peuvent ébranler la quiétude et la sécurité des citoyens et installer une forme d’angoisse. L’absence de vie sociale fait que ces angoisses ne peuvent pas être évacuées, elles donnent alors le sentiment que nous évoluons dans une société peu rassurante.
Peut-on parler de mal-être algérien ?
L’être humain n’a pas une possibilité infinie d’exprimer son mal-être. Ce sont les mêmes réponses que nous retrouvons partout sauf que chaque culture va favoriser une expression plutôt qu’une autre. Par exemple, nous sommes de grands consommateurs de sucre, l’angoisse et le stress vont multiplier le nombre de diabétiques dans notre pays, nous avons une tolérance à la violence importante surtout chez les hommes, alors, les explosions caractérielles et les colères seront un moyen d’exprimer nos tensions et nos angoisses. À ce titre, nous pouvons peut-être parler de mal-être original.
Dans quelle mesure la violence des années 90 continue de structurer nos comportements sociaux ?
La violence vécue par nos concitoyens mérite un long développement. Je voudrais définir la violence car on la retrouve dans des situations où elle n’est pas évidente au premier coup d’œil. L’OMS définit la violence comme suit : “Par violence, il est entendu l’usage de la force physique, psychique ou de pouvoir contre soi-même, une autre personne, un groupe ou une communauté et entraînant ou risquant d’entraîner des conséquences négatives sur la santé physique, mentale ou sociale de celui ou celle qui en est victime.” Il faut alors penser aux incivilités quotidiennes rencontrées dans la rue ou lors des déplacements en voiture, elles sont autant de violences qui rendent la vie sociale désagréable.
À cela s’ajoutent également les violences institutionnelles qui sont souvent des abus de pouvoir caractérisés. La plupart des violences “pensent” être légitimes, et toutes suscitent une autre violence en retour y compris dans les dispositifs mis en place pour la contenir, qu’il s’agisse de dispositifs institutionnels policiers ou médicaux lors des soins d’urgences psychiatriques par exemple. Si la violence ne semble pas être une maladie, il se trouve que la majorité des responsables, l’OMS, les journalistes comme vous proposent de l’aborder comme un problème de santé.
Par ailleurs, bizarrement, la population générale considère que la violence est un comportement qui se situe en dehors de la normalité lorsqu’elle est excessive. Le paradoxe veut que plus un acte est considéré comme très violent, et plus celui qui le commet, malade, et doit donc être excusé et innocenté. Les violences des années 90 ont modifié les comportements sociaux. Ils ont banalisé la violence et augmenté le seuil de tolérance. Ils ont installé une certaine méfiance dans les rapports sociaux, alors qu’un automobiliste en panne, la nuit, sur la route était facilement secouru, rares sont ceux qui s’arrêtent pour lui proposer de l’aide aujourd’hui.
La population en général garde l’idée que ce conflit, qui a montré une très grande violence, laisse penser que la majorité du pays est composée d’hommes ordinaires susceptibles de devenir des bourreaux volontaires si les circonstances le permettent. À propos de la violence, je voudrais terminer par trois remarques. La première est que le vingtième siècle peut être considéré comme le plus violent de l’histoire de l’humanité. La seconde remarque concerne la transmission intergénérationnelle des violences subies. Elles sont plus ou moins conscientes et se transmettent épi-génétiquement à plusieurs générations.
La troisième observation à trait à la difficulté à apporter de l’aide à la prévention de la violence. Nous avons créé une association de prévention de la violence à l’école pour former les enfants et les enseignants à la prévention. Nous avons rapporté des programmes pour chaque niveau scolaire du Canada que nous avons traduits et adaptés dans des écoles privées, mais jamais nous n’avons eu accès aux services d’enseignements publics. Ces programmes validés sont restés dans les cartons à ce jour comme si la violence n’avait jamais eu lieu et qu’il fallait tourner la page.
L’Algérien a-t-il fait sa thérapie de la décennie noire ?
Je ne sais pas ce que vous entendez par thérapie ! Si vous voulez dire par là : est-ce que la société dans son ensemble a analysé et a partagé des avis sincères à propos des bouleversements violents de la décennie noire ? La réponse est non. Car comme d’habitude, nous avons mis un couvercle en oubliant d’éteindre le feu.
La vérité n’était-elle pas nécessaire pour les victimes et plus largement pour l’ensemble du corps social ?
Évidemment que la vérité a toujours de l’importance. Mais il ne faut pas être naïf. Le problème est que la vérité est toujours complexe. Chacun a sa vérité, il n’y a pas de vérité absolue. On pourrait définir la vérité comme ce que chacun de nous accepte de croire. Il n’y a pas de vérité objective, il faut donc organiser un consensus qui permette à chacun et à tout le corps social de se retrouver. D’où le rôle des historiens et du travail de mémoire en temps de paix pour élaborer l’Histoire, l’arbre d’un peuple commençant par ses racines.
La société algérienne est passée par plusieurs épreuves cet été. Crise de la Covid, incendies de forêt meurtriers, pour ne citer que celles-là. Comment ces traumatismes sont-ils ressentis par les Algériens. Quelles séquelles laissent-ils ?
Tous les traumas laissent des traces. La trace laissée sur les enfants est fonction de leur âge, sur les femmes, les traces sont les dernières à être prises en considération, sur ceux qui ont côtoyé les personnes décédées et ceux qui ont rencontré la mort ne se ressemblent pas. Ceux qui s’enferment dans les revendications et les sentiments d’injustice, ceux qui conservent une angoisse de mort et des insomnies et ceux qui ont aggravé leurs phobies ou leurs obsessions ne vivent pas les mêmes tourments.
Les séquelles seront développées en fonction de la gravité de la souffrance, de l’isolement affectif et social vécu, du sentiment d’injustice, de la force de la croyance et de la qualité de l’environnement. Ceux qui ont traversé l’épreuve en famille et ceux qui étaient seuls face à l’adversité ne garderont pas les mêmes tourments. Cela dit, il faut être attentif aux besoins de ces victimes, développer l’offre de soins, mais également les besoins sociaux.
La migration clandestine des Algériens a littéralement explosé ces derniers mois. Comment analysez-vous ce phénomène ? Peut-on dire que la harga est une forme de folie ?
La harga n’est certainement pas une forme de folie si vous considérez que la folie c’est l’équivalent de la perte de la raison. Vous savez, une action humaine est toujours complexe et multifactorielle. Il aurait été judicieux de proposer un questionnaire à tous ceux qui ont tenté l’aventure pour analyser leurs motivations, afin de proposer des solutions concrètes à ces désespérés. Il faut prendre conscience que le monde a changé et que notre pays, également, a changé. Nous étions plein d’espoir et de convictions qui ont été régulièrement remplacés par des déceptions et des doutes concernant l’avenir.
Parallèlement, l’ouverture du monde, internet et les réseaux sociaux montrent des images de rêve et offrent des complicités universelles, la harga offre une illusion de liberté et d’amour. On se découvre comme les adolescents à rêver d’un avenir heureux sans contrainte en traversant simplement une fenêtre. L’Algérie est un grand pays, magnifique, riche d’histoire et d’avenir, mais personne n’est en mesure, aujourd’hui, de le dire et de l’exprimer à ces malheureux.
Pourquoi, selon vous, de plus en plus d’Algériens envisagent de quitter le pays ? L’Algérie n’est plus un pays où il fait bon vivre !
Il ne faut pas oublier l’effet mode pour ceux qui envisagent de partir et l’effet commercial de ceux qui s’adaptent rapidement à ce que peut rapporter l’effet mode. Ceux qui gagnent à chaque départ sont les instigateurs de ce drame renouvelé. Les parents sont parfois complices soit parce qu’ils participent financièrement à l’opération, soit par ce qu’ils transmettent aux enfants en leur disant par exemple qu’il ne fait pas bon vivre dans le pays et qu’il faut chercher fortune ailleurs. Il faut croire que nous avons transmis aux parents l’idée que le travail ne paye pas, et que le pays n’a plus d’avenir. La multiplication d’associations destinées aux jeunes pour les encadrer, leur faire connaître le pays, les accompagner et les soutenir en cas de difficultés psychologiques me semble une nécessité urgente.
Les violences contre les femmes ont pris des proportions alarmantes comme l’illustre le nombre de féminicides. De quoi cette violence est-elle le nom ?
La violence contre les femmes a une base sociale et culturelle. Elle est maintenue par le comportement des responsables et des personnes qui voient les femmes grignoter l’espace public qui leur était réservé. Les femmes sont majoritaires dans toutes les universités. Elles sont dans tous les postes de travail, elles s’imposent dans les grandes villes. Plus leur présence est visible, plus elles seront agressées. Le confinement a contribué au tête-à-tête agressif dans les familles et le système judiciaire ne prend pas cette évolution inéluctable de la société au sérieux.
La société algérienne est-elle violente comme on a tendance à l’asséner ? Qu’en pense le psychiatre ?
Aucune société n’est violente, mais toutes peuvent le devenir. La violence est un comportement humain menaçant et contagieux. Elle suscite, de ce fait, fascination et sidération, ce qui explique l’engouement des jeunes pour les jeux violents sur internet et la variété des films violents proposés. Si la période des violences sociales que nous avons a peut-être aggravé nos réactions violentes en augmentant notre seuil de tolérance, il faut réagir ensemble pour changer ce comportement car il ne suffit pas de condamner la violence dans toutes ces expressions pour s’en prémunir.
Il faut s’en méfier, être prêt à en reconnaître l’existence et son développement en soi, chez son voisin et dans son groupe social. Aucune société, aucune personne ne peut se considérer immunisée contre la réaction violente. Il suffit parfois de peu de chose pour que les conditions se créent, pour que les massacres et le chaos prennent à nouveau le dessus. Il est évident que ce devoir de vigilance ne peut pas relever que d’un seul domaine, ou d’un seul ministère, c’est un devoir qui relève d’abord de chaque citoyen et de tous les services ministériels. Je terminerai en rappelant que les programmes de prévention de la violence existent, ils ont été validés et adaptés, ils doivent éveiller la conscience des responsables de l’éducation.
Le suicide est comme occulté dans notre société. Est-il un phénomène marginal et que révèle-t-il en définitive ?
Le suicide est un comportement complexe qui a fait l’objet de ma thèse de doctorat, il y a plus de cinquante années. Je lui ai consacré plusieurs chapitres dans mon dernier ouvrage Parole de psychiatre, édité, il y a de cela deux mois aux éditions Koukou, Alger. Ce n’est pas un phénomène marginal, mais nous avons des chiffres moyens par rapport aux autres pays. Nous avons un chiffre déclaré de 3 à 4 suicides pour 100 000 habitants, ce qui donne près de 1 500 décès par suicide chaque année, lorsque le Japon déclare 19,5 et la France 16. Les tentatives de suicide sont, par contre, plus nombreuses et elles touchent plus fréquemment les adolescents.
Paradoxalement, la conduite suicidaire est souvent le signe d’un désir de vie et de diminution de la souffrance. Elle ne signifie pas toujours l’existence d’un profond désir de mort. Pourquoi avons-nous des difficultés à en parler ? Parce que c’est d’abord un acte vécu comme une offense à Dieu et comme une terrible agression adressée à la famille, à la société et au système politique. Vous pensez bien que la vérité est beaucoup plus complexe comme à chaque fois que nous avons affaire à un comportement humain.
Lors de grandes mobilisations du Hirak, les Algériens se sont montrés aussi pacifiques que civiques. Quel regard pose le psychiatre sur cette expression sociale collective ?
Après une guerre civile meurtrière, voilà qu’un mouvement pacifique a poussé la population du pays dans son ensemble à affirmer son désir de vivre en paix. Ces immenses marches développées dans toutes les grandes villes ont revendiqué un changement politique. Peuvent-elles être interprétées comme une tentative cathartique de répondre aux violences sociales vécues et de tout tenter pour tourner la page et ne plus y revenir ?
Les jeunes et les moins jeunes ont bravé leurs peurs pour aller au-delà des conflits sociaux et dépasser les différences. Ces conflits sociaux qui n’ont pas été suivis ni d’excuses ni de marques rappelant la souffrance des uns et les débordements des autres. Aucun geste n’a été fait pour transcender les violences, leur donner du sens et les inscrire dans un droit à la différence comme des symboles révérenciels ancrés dans l’imaginaire collectif.
Ce mouvement populaire inédit a-t-il changé le comportement des Algériens, individuellement et collectivement ? N’a-t-il pas été une sorte de thérapie de groupe ?
Le Hirak a-t-il visé à imposer une citoyenneté, un vivre-ensemble et pas simplement vivre “à côté”, une réconciliation imposée sans réparation ni symbolique ni matérielle ? Le fait que ce mouvement ait existé, qu’il se soit généralisé et répété pendant des mois est en soi une victoire pour tous ceux qui aiment ce pays et qui rêvent d’un meilleur avenir. Je pense que ce mouvement a changé la réflexion des Algériens, et de toute évidence, il a tenté de le faire. Il manque une étape à ce grand mouvement ? La consécration effective des aspirations qu’il porte.
Entretien réalisé par : Hassane OUALI et Karim BENAMAR






