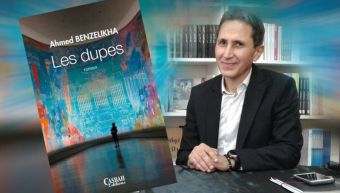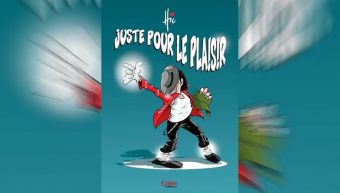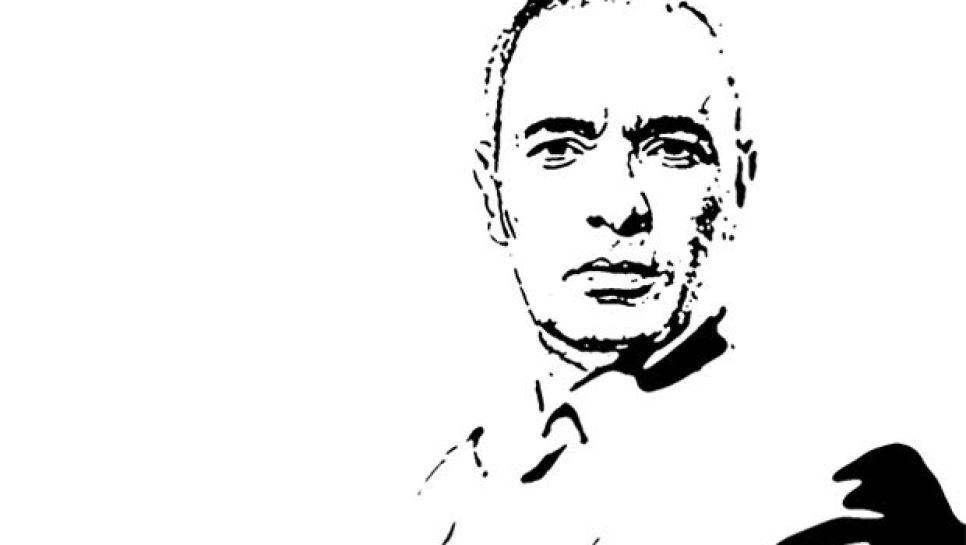
Par : KAMEL DAOUD
ÉCRIVAIN
Il faut des années, beaucoup de voyages et d’attention pour déplier en soi cette évidence et l’accepter : ici, on ne sait pas encore être libre. C’est une scandaleuse conclusion, mais elle est réelle, du moins pour l’auteur. Arrivée à un aéroport algérien à partir de “l’Extérieur” (El-kharedj), l’accueil est “policier”. “Passez !” lance martialement l’agent. Sa mine est sévère, il scrute le retour des “dissidents” à la caserne nationale, les fuyards enfin repentis, contrits par le remords d’avoir abandonné la terre natale.
On devine que la frontière chez nous, dans l’atmosphère de nos symboles, est inquiétante, félonne et source de peur et d’agression. Ainsi, ceux qui la traversent sont surveillés comme des traîtres, des dissidents de retour. Chaque voyageur est un “agent double”, ou un contrebandier. C’est notre univers de guerre et de méfiance qui ordonne le casting de nos représentations mentales.
L’agent policier ne sait pas dire “Mar’haba”, bienvenue, s’il vous plaît ou sourire. Il est chargé, par l’histoire nationale, d’une mission : la vigilance aux limes. Mais ce policier n’est pas le seul à reproduire la guerre et ses gestes chez nous. Le gendarme, le militaire (l’habitude de partager la population entre plèbe “Eccha3bi” et “Dawla”, État), l’Agent, l’Administrateur.
Un Algérien n’est pas le même qu’il soit de ce côté (client) d’un guichet ou de l’autre (employé). Du premier côté, il reproduit la ruse, la patience, l’humilité ou la colère qu’il avait devant l’Administration coloniale française ou ottomane ou autre. Du côté employé, il n’a d’autre manuel de comportement que celui du colonisateur, soldat occupant, envahisseur. Il en devint insensible, arrogant, méprisant.
Cette intuition frappa très tôt l’auteur : on ne sait pas faire autre chose, dans l’univers de nos signes, que reproduire ce duo. L’agent de l’État, le policier traite la population selon cette symbolique : il la surveille, s’en méfie, la scrute comme une menace, fait contrepoids à sa propension au chaos. “Sans nous (policiers), ces gens, ce peuple, peuvent s’entredévorer”, me lança un jour un policier, les yeux plissés, les mains derrière le dos, face à trois personnes qui en sont venues aux mains dans un village.
Un ancien Premier ministre rappela un jour, lors d’une campagne électorale en faveur de l’ex-dictateur, cette dette : “En 62, vous n’aviez même pas de chaussures et l’État a été là pour vous.” Un ministre, en visite dans le pays profond, n’arrive jamais que selon les rites d’un libérateur : cortège, voitures ombres, lunettes noires et générosités des “inaugurations”.
L’Administration algérienne est, dans son essence, bâtie sur la croyance que son administré est traître et menteur : la bureaucratie en tire sa légitimité. Et les Algériens sont souvent plus solidaires pour alerter sur la présence d’un radar de contrôle de vitesse sur une route (c’est un instrument de l’ordre dominateur) que pour boiser un désert.
Mais cette peur, cette impuissance à être libre, envisager la liberté comme scandale nécessaire, désordre, individualisme et dissidence n’est pas le monopole de l’ordre. Il l’est aussi de son opposition. L’auteur a été frappé par cette peur qu’avait le Démocrate (comme type culturel) de la liberté, sa haine parfois envers l’Autre. Lors du soulèvement du 22 février 2019, on se scandalisa de la joie, de la danse et des couleurs de ce mouvement. Il fallait, selon l’Opposant Parfait, y garder la solennité de la mort, la raideur du monument et du martyr cadavérisé. Puis on mena le mouvement vers la posture.
“Traître”, “vendu”, agent, espion. Les anathèmes sont-ils le capital du Régime quand il est en colère contre un libéré ? Non. Ils sont encore plus ceux des “démocrates” qui s’en servent contre ceux qui ne partagent pas l’unanimité de l’avis, le parti unique de la pensée opposante orthodoxe.
Étrange enfermement : même celui qui se bat pour la liberté ne sait pas l’imaginer que comme chute du Régime, sans au-delà mature et consensuel, acceptation ou pluralisme. Rien n’égale la propagande du Régime, souvent, que la violence des “pairs” démocrates et leur penchant pour le parti unique “démocratique”.
Enfants, eux aussi, du même piège, du même enfermement, de la même peur panique face à la différence, face à la belle singularité, l’inconnu vertigineux. Les voilà souvent, très jeunes, à imiter la posture des martyrs, rêver de prison pour s’anoblir et de sang sous la matraque d’un policier pour gagner l’ordre du respect selon le panthéon de la décolonisation épique.
Si jeunes, ils aiment jouer aux morts et aux martyrs. Et quand ils sont âgés, ils se convertissent en apparatchiks endoloris par leurs vieux militantismes. On peut s’en offusquer et l’auteur y céda, entrer en colère contre cette déception apportée par les “siens” démocrates, ou s’éloigner de cette toxicité, mais il s’agit-là aussi d’une avarice. La “démocratie” signifie encore exclusivement faire chuter un Régime et non pas construire un pays. D’ailleurs, parfois la “démocratie” n’est pas le contraire du “pouvoir” mais seulement l’envie de le prendre et d’en dégager l’autre.
Cette envie de rejouer l’histoire on la décrypte jusque dans la haine de la France chez qui on scolarise ses enfants à Alger ou dans l’envie de devenir un ancien moudjahid en lapidant Benjamin Stora.
La réalité, douloureuse, intime, est que les uns, comme les autres, du démocrate au policier des frontières, on est peut-être piégé par un univers de souvenirs et un manque d’imagination : rien n’est plus agresseur pour nous, plus angoissant que la liberté.
On se barricade contre sa beauté vertigineuse derrière la religion féroce, le dogme de la sécurité, les sectes d’opposition, le culte des ancêtres ou le repli sur la gloire. Pourtant, on ne vit pas les “six” du 1er Novembre 1954 se réclamer d’ancêtres et de gestes épiques, mais d’un pari fou et désordonné sur l’avenir. Il n’y eut pas, en ce moment, d’imitation, mais une inauguration.
En comparaison, si loin dans le temps, on en est incapables. Il y a même une manière, scandaleuse et pourtant utile de relire Fanon aujourd’hui ou, surtout, Albert Memmi dans son “Portrait du décolonisé” sciemment négligé par les nouveaux décolonisés.
On s’y exercera, comme bénéfice, à la lucidité sur soi, si dangereuse, mais surtout on peut y baptiser un chemin fou, un pari et un pardon : à la fin, on s’aimera, peut-être, nous-mêmes. S’aimer soi-même ? Oui, car nous, les Algériens, on ne s’aime pas. Pas encore. Et cette guerre intime, au cœur d’un corps unique, nous épuise. Après avoir libéré le pays, nous nous y sommes enfermés dans la réclusion et alors, orphelins et perdus, nous avons rejoué nos solitudes.
“Ce sont des âmes d’ancêtres qui nous occupent, substituant leur drame éternisé à notre juvénile attente, à notre patience d’orphelins ligotés à leur ombre de plus en plus pâle, cette ombre impossible à boire ou à déraciner, l’ombre des pères, des juges, des guides que nous suivons à la trace, en dépit de notre chemin, sans jamais savoir où ils sont, et s’ils ne vont pas brusquement déplacer la lumière, nous prendre par les flancs, ressusciter sans sortir de la terre ni revêtir leurs silhouettes oubliées, ressusciter rien qu’en soufflant sur les cendres chaudes, les vents de sable qui nous imposeront la marche et la soif, jusqu’à l’hécatombe où gît leur vieil échec, chargé de gloire, celui qu’il faudra prendre à notre compte, alors que nous étions faits pour l’inconscience, la légèreté, la vie tout court, etc”.Je laisse au lecteur le soin de retrouver le sublime auteur, algérien, de cette citation.